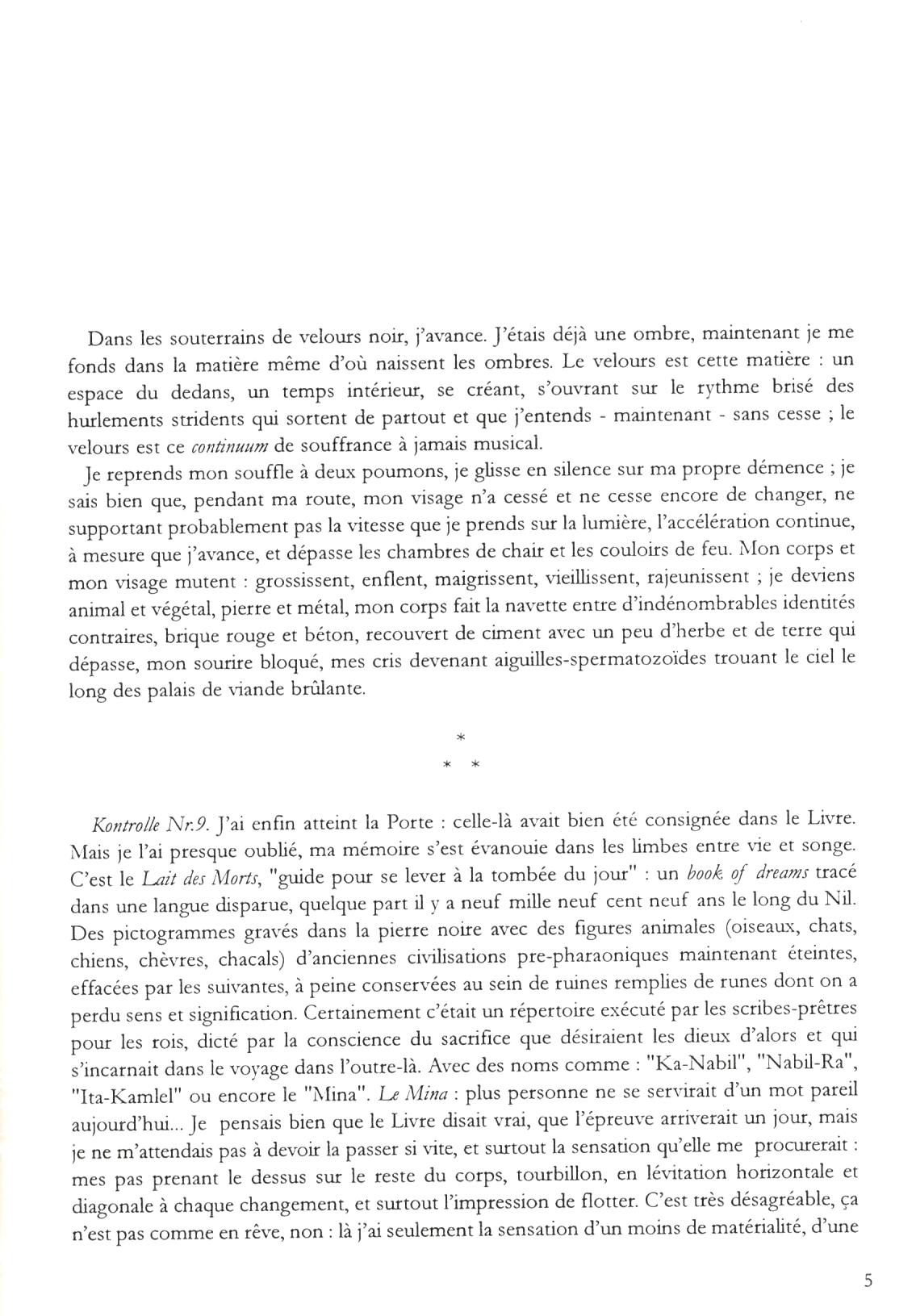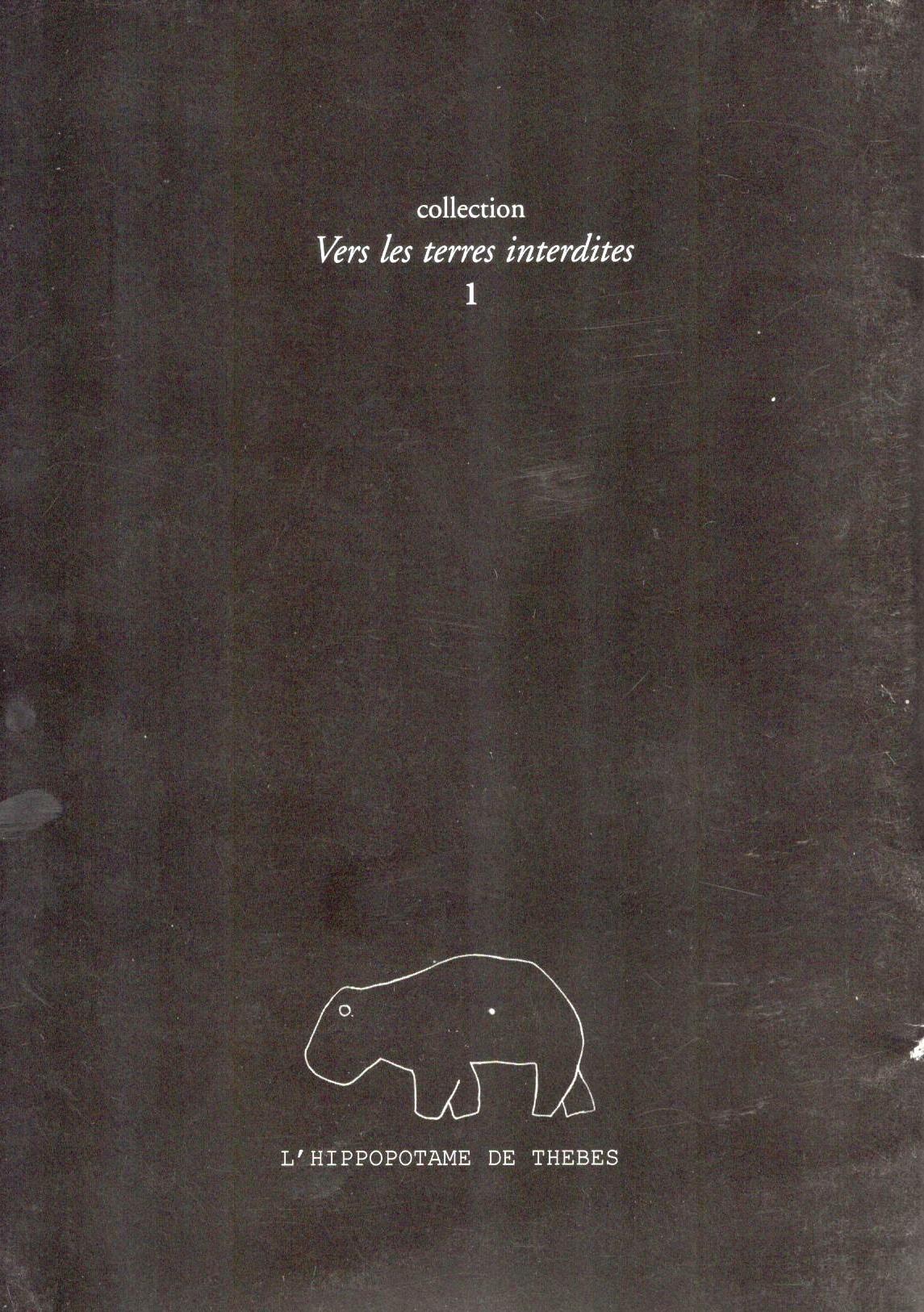Paru en 1998
Contexte de parution : L’hippopotame de Thèbes
Présentation :
Texte écrit entre décembre 1997 et juillet 1998.
Publié sous forme de plaquette par L’Hippopotame de Thèbes en septembre 2000 et depuis longtemps épuisé.
Image de Scott Batty.
Dans les souterrains de velours noir, j’avance. J’étais déjà une ombre, maintenant je me fonds dans la matière même d’où naissent les ombres. Le velours est cette matière : un espace du dedans, un temps intérieur, se créant sur le rythme brisé des hurlements stridents qui sortent de partout et que j’entends maintenant sans cesse. Le velours est ce continuum de souffrance à jamais musical.
Je reprends mon souffle à deux poumons. Je glisse en silence sur ma propre démence. Je sais bien que, pendant ma route, mon visage n’a cessé et ne cesse encore de changer, ne supportant probablement pas la vitesse que je prends sur la lumière, l’accélération continue, à mesure que j’avance, et dépasse les chambres de chair et les couloirs de feu. Mon corps et mon visage mutent, grossissent, enflent, maigrissent, vieillissent, rajeunissent. Je deviens animal et végétal, pierre et métal, mon corps fait la navette entre d’indénombrables identités contraires, brique rouge et béton, recouvert de ciment avec un peu d’herbe et de terre qui dépasse, mon sourire bloqué, mes cris devenant aiguilles-spermatozoïdes trouant le ciel le long des palais de viande brûlante.
Kontrolle Nr.9. J’ai atteint la Porte : celle-là avait été consignée dans le Livre. Mais je l’ai presque oublié, ma mémoire s’est évanouie dans les limbes entre vie et songe. C’est Le Lait des Morts, guide pour se lever à la tombée du jour : un livre de rêves tracé dans une langue disparue, quelque part il y a neuf mille neuf cent neuf ans le long du Nil. Des pictogrammes gravés dans la pierre noire avec des figures animales (oiseaux, chats, chiens, chèvres, chacals) d’anciennes civilisations pré-pharaoniques maintenant éteintes, effacées par les suivantes, à peine conservées au sein de ruines remplies de runes dont on a perdu sens et signification. Certainement c’était un répertoire exécuté par les scribes-prêtres pour les rois, dicté par la conscience du sacrifice que désiraient les dieux d’alors et qui s’incarnait dans le voyage dans l’outre-là. Avec des noms comme ceux de Ka-Nabil, Nabil-Ra, Ita-Kamlel ou encore le Mina. Le Mina : plus personne ne se servirait d’un mot pareil aujourd’hui... Je pensais bien que le Livre disait vrai, que l’épreuve arriverait un jour, mais je ne m’attendais pas à devoir la passer si vite, et surtout la sensation qu’elle me procurerait : mes pas prenant le dessus sur le reste du corps, tourbillon, en lévitation horizontale et diagonale à chaque changement, et surtout l’impression de flotter. C’est très désagréable, ça n’est pas comme en rêve. Non, là j’ai seulement la sensation d’un moins de matérialité, d’une désagrégation. Ma chair me brûle, elle se dissout en aphtes et se décompose en mille tissus, se détisse molécule après molécule. Une ombre me dépasse, ouvre la porte, c’est Ita-Kamlel, m’attendant pour la dernière épreuve et maintenant me devançant pour m’introduire au conseil suprême.
Je quitte les souterrains de velours, à cet instant. Ce qui était derrière moi disparaît dans un vent rapide de fumée noire. Il se fait un instant de pur silence. Les hurlements s’évanouissent et renvoient un rapide feed-back avec beaucoup de réverbération qui disparaît à son tour lorsque j’entre à l’intérieur de Kontrolle Nr.9. La pièce est noire, elle aussi, mais en métal. Elle est parfaitement carrée, deux moniteurs placés de chaque côté de manière symétrique et, au centre, un petit autel. Dans toute la pièce j’entends un son légèrement étouffé de signal relativement persistant, comme un sifflement monotone venu de quelque part au bout de l’espace-temps.
À ma droite, le moniteur diffuse des images publicitaires très vulgaires, couleurs criardes, jingles hurlants. Ka-Nabil est le nom du premier moniteur. Ka-Nabil est consigné dans le Livre comme le fond incréé sur lequel furent bâties toutes choses... Je reprends ma respiration, je tente de le prononcer : Ka-Nabil...
Dans le rose et le bleu des images diffusées, je vois des familles américaines-internationales qui essaient et proposent nourritures, voitures, produits ménagers, cosmétiques, médicaments, cannes à pêche multifonctions, produits à la dinde, animaux malades, enfants morts, nouveaux dieux et politiques immémoriales. S’accumulent des images de maisons californiennes d’une religieuse vulgarité et des escaliers pour le coup vraiment obscènes... C’est la première fois que je vois les escaliers obscènes qui avaient été inscrits dans la pierre... Les slogans qui ressortent des cycles publicitaires semblent parfaitement aléatoires, comme tirées d’une machine à piocher des segments de phrase et les associer au hasard, pour aller plus vite, devenir plus efficace (et même si le sens se perd). Je les reçois simultanément mais ma mémoire me les reconstitue ensuite de manière successive : « Dieu est encore là pour un laps de temps très court : deux mois » ; « Une infortune amoureuse vous poussera bien à prendre de la femme » ; « De la mort on en revient » ; « Une grande lumière fraie sa voie fragile dans les ténèbres » ; « Dieu est dans un loft crasseux habité par trois gouinasses » ; « Et je me réveille mais je sais leurs noms » ; « Le Grand crime de la Beauté va influer directement dans un vieux livre lointain » ; « Montons avant que le monde ne m’ait rattrapé »...
À ma gauche, sur le moniteur aux images qui semblent devenir un peu gluantes et dégoulinantes comme de la slime, c’est de la pornographie filmée en vidéo amateur. C’est Nabil-Ra, bien sûr et à quoi d’autre s’attendre ? Nabil-Ra est la dernière corde qui rattache l’homme, le « passeur », au réel... Comme le souvenir le plus prégnant des hommes, celui qu’ils se cachent jusqu’au bout mais qu’ils conservent jalousement...
Nabil-Ra : Je l’ai dit, maintenant je peux l’apercevoir et lire sa réponse... Bien sûr, je sais bien qu’au bout du compte les gens ne voudront retenir que ça avant de partir : quelques images de pornographie amateur… Je reconnais sur l’écran, au centre de l’image, de très basse qualité, la jeune femme qui est en train se faire tringler dans un tea-room insupportable par un gros camionneur avec des tatouages. C’est Diane, une jeune noire l’air américaine. Je ne pensais pas qu’elle avait pu faire du porno, même dans un songe. Elle, étudiante modèle, camarade de classe si sympathique, serveuse dans un fast-food le week-end pour payer ses études. C’était même la petite amie pour un temps de mon ami Guy End. J’observe plus longuement le moniteur : elle semble jouir, vraiment, dans le porno : ça n’est pas du tout du viol ou quoi que ce soit de ce genre. Même pas un job pris pour des raisons financières : c’est ça qui est atroce, et pourtant... Pourtant il m’arrive quelque chose d’étrange. Devant ces images, j’ai une érection. Mon sexe est vraiment dur. Me démange ce désir de caresser le corps de Diane, un corps si souple, agile, réceptif, alangui, délicatement lascif... Avec ses bas blancs, son visage au sourire mensonger que frappe la froide lumière des lampes halogènes, ombres bleues couleur de contre-ciel sous la véranda, stries bleues et noires sur le parquet ciré... Et les petits pétales d’argent dans ses yeux... Je pense bien que je suis devenu cinglé avec cette petite machine à démonter le Temps. J’ai joué avec elle jusqu’à ce qu’elle crisse, grince, râle...
C’était donc ça et c’était donc ici. L’ombre d’Ita-Kamlel pointe le cœur de Kontrolle Nr.9. J’avance. Sur l’autel, avec un sentiment intense de sacré, je découvre, posé en évidence, l’objet du culte : un pendentif genre cadeau de Noël bien gentil, bien rassurant. C’est une petite coquille d’escargot en argent, nommée Alice au Soudan, avec quelques mots gravés en lettres d’or :
Tu es voué à des
actes seuls
Avec un minimum de signification
Et un maximum d’immédiateté
Mais alors
Du plus profond de son mystère
Bondira une pensée
Ce sera la preuve
*
* *
Lentement je me réveille du songe. Je pense encore à Diane, sortie de baiser, observant le tea-room insupportable, ses ailes de chair rognées, sa poitrine et son sexe recousus, semblable à Caroline Baltimore au sanatorium. Mes mauvais souvenirs ont pris le dessus et contaminent le dessous, leur envers fait ma crainte à l’endroit du revers de ma robe de chambre rouge, comme la mémoire du feu dans mes songes de Lait des Morts. Je sors en fait d’une migraine de plus de deux semaines. C’est à cause d’elle que j’ai dû abandonner mon stage en sémantique médiatique, rapatrié à Sainte-Caroline les bras écartés, en nage, il fallait tout arrêter. « Tension galloise » avait dit le médecin pour tout diagnostic, quoique ça puisse signifier. Aujourd’hui les mots ne veulent plus rien dire. Nos grammaires sont devenues dingues, tout simplement dingues. Je me lève, ouvre la fenêtre et, dans le calme des fleurs cannibales qui encerclent ma chambre, je vois à nouveau le pendentif Alice au Soudan, la petite coquille d’escargot en argent, avant que tout ne disparaisse encore dans ma mémoire, dans un fondu avec un peu de fumée noire.
Soudain je retombe dans le
rêve. Un autre rêve. Je suis dans une salle
d’attente très ordinaire, du type cinq heures du
matin, avant que le soleil ne se lève et pas de machine
à café à l’horizon. Et je regarde,
effrayé, une jeune femme assise devant moi, brune, en
imperméable mastic, l’air moyen-orientale assez
classe. Elle pointe avec précision le point de faiblesse,
entre mes deux yeux, et son regard magnétique s’y
perd. Elle ouvre la bouche, lentement me parle :
– Vous travaillez pour l’E.S.S.T. ?
Je ne sais pas quoi répondre, je suis à peu près sûr qu’elle y travaille. Ce qui me fait peur, c’est que moi, également, en effet, je puisse en faire partie. Il est des réseaux si subtils, des sociétés de contrôle si fluides qu’on y travaille malgré soi, sans avoir aucun espoir de le savoir avant sa mort. Une migraine menace de poindre, cependant, vite, je sors du rêve.
Sainte-Caroline est la plus charmante ville au monde. À peine trois mille habitants, à peine le cinéma, un vent magnifique, un climat froid et lumineux. Mais c’est là que s’est organisé ce que les journalistes ont appelé le nouvel ordre visuel et auditif (N.O.V.A.), et sa branche de contrôle psychique : le nouvel équilibre générique de manipulation audiovisuelle (N.E.G.M.A.). C’est la plus récente alliance, on l’appelle le Mina, matrice internelle de néoténie assistée (M.I.N.A.), le nouveau bébé de conscience collective au cœur de viande qui ne demanderait, pour son utopique réalisation, que la destruction de tout le reste, corps et organes inclus.
Honnêtement je n’en sais rien. C’est ce que disent les journaux et qui suis-je pour juger ? Ca devient souvent transrationnel, le cours des choses, dans la course des mots qui créée notre réalité présente. En moi, par exemple, quand je dis ça, il y a deux choses qui apparaissent simultanément dans la pensée. C’est ce qui crée l’urgence et la difficulté. Je crois encore en Dieu. Puis : Dieu est dans un loft crasseux habité par trois gouinasses. Il n’en a pas pour longtemps : deux mois. Deux mois. Voilà comment ça marche. Je suis perdu, certes, mais, à ma place, que feriez-vous ?
Avant mon « absence », mon meilleur ami, Guy End, avec qui je conversais régulièrement par courriers électroniques, a disparu. Je le connaissais de l’école, lui et sa sœur. Et Diane. Et notre bonne camarade Caroline Baltimore. Tous du Lycée-Mathématiques, un grand bâtiment en amiante argenté au centre de Sainte-Caroline, place Sainte-Anténoëlle, au croisement avec la rue Sainte-Justine. Guy End était devenu, avec les années, de moins en moins causant, à peine aimable, concentré sur je ne sais. Il ne parlait pas, ne sortait pas, mais passait beaucoup de temps à communiquer. Forums de discussion, emails, jeux pilotés par le net et tout le bordel. Il en était arrivé à une sorte d’ataraxie bizarre, proche de l’absence au monde, et finalement, après un dernier courrier (« Je sais ce que j’éprouve et je me suis fait à l’idée de ma disparition »), il a réalisé ce qu’il pensait. Je suis allé chez lui très vite, très inquiet : mais plus personne, trop tard ! Une forte odeur de cassis emplissait l’ensemble du studio. Sur l’écran de son ordinateur, un mug de café virtuel tournoyait, une spirale inscrite dessus, en silence. C’est le premier signe, m’étais-je dit. Le café noir possède plus de contrôle sur les cinq sens qu’un ange d’opéra.
Je suis tombé malade juste
après : migraine intense, dégoût de tout et
fièvre de cheval. Et de cette maladie bizarre, je garde
encore un séquelle : une sorte d’infection entre mes
testicules et ma jambe droite qui s’est
développée. Ca fait une boule purulente de chair et
de pus. Je l’observe dans son absurdité terrifiante.
Ma grand-mère, avec qui je vis, a appelé le
médecin. Il m’a ausculté et a simplement dit,
remettant ses lunettes cerclées d’un geste automatique
:
– C’est un œuf. Cinq jours de repos pour vous,
jeune homme.
– Un œuf ? Ca n’a pas de sens...
– Vous voulez m’apprendre mon travail ? Si vous
n’êtes pas content, adressez-vous au professeur Thomas,
jeune homme, ou ce qu’il en reste…
Ca a été très dur, je suis très léger maintenant. Malgré la boule qui me fait spécialement mal, je suis joyeux, insouciant, très enfantin pour mes vingt-deux ans. Je fais mes courses tous les jours au supermarché bleu ciel de Sainte-Caroline, place Sainte-Augustine, au croisement de la rue Sainte-Irène, avec ma grand-mère qui est, semble-t-il, de plus en plus petite, trapue, bavarde et habillée en rose. Elle parle tout le temps. Moi, je ne dis rien, je souris. Je suis comme sorti de la mort. Je pousse le caddie avec désinvolture, rempli comme il est de mille et un merveilleux produits, comme ceux des publicités américaines-internationales ; ma cigarette allumée disposée soigneusement entre l’index et le médium de ma main gauche, je ne cesse de sourire, et c’est toujours une belle journée, aujourd’hui, tous les jours.
Quand nous passons devant le rayon des thés glacés, une migraine effleure mon visage. Je repense à Alice au Soudan mentionné sur le pendentif. C’est une chanson et c’est un lieu. Et il faudrait que j’aille vivre là-bas, ce trou rouge dans mon passé, présent dans l’absence que le nom donne à ce qu’il signifie et sa récurrence dans ma vie, comme un disque de ma plus romantique jeunesse. Je contrôle difficilement ma tendresse pour cette chanson, cet air populaire, son accompagnement au bandonéon, le solo de saxo si mélancolique qui l’achève à chaque fois. Et cette voix noire, morte avant... J’ai appris pas mal de choses ces derniers temps. Pas difficile avec ce qu’est devenu ce cher Guy et tous les présages. Mais finalement tout retourne à cette chanson, une vie ne suffirait pas à l’éprouver.
Sa
notoriété
Sa trop grande beauté
Cette humiliation
Manque de compassion
M’empêchent de dormir
Me font tant souffrir
Mais comme je suis loin
Loin de tout potin
Je me dis franchement
Pensons largement :
Qui est
Alice
Au Soudan ?
– Bibiche, me dit ma
grand-mère, tu devrais te reposer davantage, avec ton
œuf... Qui sait, peut-être que tu es
enceint...
– Enceint ? Enceint d’une pensée ?
– Quoi ? Quoi ? Quoi ? Pardon ? Bibiche ?
– C’est rien, Mamie, je pensais tout haut.
– Tu pensais à quoi ?
– Oh, à la disparition de Guy...
– Ah oui, tu sais, pendant ta maladie, on en a
répertorié une bonne trentaine, de disparitions,
comme ça, et rien qu’à Sainte-Caroline.
Étrange, hein ?
*
* *
C’est trop tard pour penser à Guy et trop tôt pour penser à moi. Je descends alors, vers cinq heures, je vais boire un verre au bar des Innocents, rue Sainte-Justine. C’est le bar le plus populaire de la ville. Ils ont des cocktails qui explosent le goût comme des supernovae, remplissent le crâne de pensées heureuses et presque bêtes. La vie estudiantine sainte-carolinienne y bat son plein.
Pendant que l’on boit, le café diffuse un air latino et un interminable film anglais couleur fraise au rythme chaotique dont les images inlassablement reviennent en boucle, répétant l’histoire. C’est le film le plus étrange que j’ai jamais vu. L’héroïne est une petite fille de treize ans, blonde, avec un visage très pur, bien sûr, et un nœud blanc dans les cheveux. Elle garde un bébé chez sa marraine, la duchesse de ***, qui vit dans les landes. Le bébé pleure sans arrêt. Il hurle comme un veau ou un petit porc le visage barbouillé de marmelade d’orange. Elle tente de le faire taire, chante des comptines, des berceuses. Mais progressivement, à l’effroi de l’héroïne, le bébé se transforme en une large courge de matière physique indifférenciée. L’héroïne hurle à son tour. Je ne peux pas l’aider. C’est un film qui se diffuse lentement dans ma tête. Un poème qui s’inscrit, se grave dans le cerveau avec un stylet à la fraise de sucre. Et je commence à avoir sérieusement la migraine.
Progressivement il me semble qu’il y a moins de monde dans le bar, cependant personne ne part : ils s’absentent… Une fille jusque là assise au comptoir vient s’asseoir à ma table. Brune, elle porte des boucles d’oreilles en forme de cœurs argent, des bas blancs, une longue robe noire et une violette à la boutonnière. Je la reconnais : c’est Dolorès, Dolorès End. Je retrouve la manière cinématographique et racée dont jeune déjà elle détachait ses longues jambes électriques des lumières et des ombres jetées sur le tableau noir du Lycée-Mathémathiques.
C’est la sœur de Guy
End. Nous parlons de son frère, de combien nous le portions
dans nos cœurs. Je l’écoute, je l’aime...
Mais au fond de mon cœur j’ai très peur car
Dolorès serait capable de vouloir faire l’amour avec
moi, n’est-ce pas, et je suis enceint, je ne sais pas comment
bébé réagirait. De plus, j’ai
déjà bien du souci à m’en tenir à
mes seules sensations ; moi, je n’ai jamais aimé une
femme jusqu’à présent, voire embrassé
une…
– Guy End, me dit Dolorès avec nervosité dans
le creux de l’oreille, faisait partie de ces hommes choisis
contre leur gré par le Mina… Choisis pour être
des sortes de saints, tu sais, de beiges flaques
d’antimatière, les victimes annonciatrices d’une
mutation cosmique… Voilà le monde de la fin des
temps, cher… Et seuls quelques-uns uns ronronnent...
N.O.V.A, N.E.G.M.A., M.I.N.A.... Un vrai cauchemar…
– Mais qu’est-ce que c’est, le Mina ?…
– Tu le reconnaîtrais facilement, je crois :
c’est le grand chien de viande qui se tient assis au
cœur de la ville... Tu vois ? Il a été
installé par des hommes qui voulaient l’utiliser comme
instrument de contrôle mais maintenant ils ont perdu le
contrôle de leur instrument… Quelqu’un a dit
qu’il est peut-être, réincarné,
reformulé par l’esprit humain, la matrice de
l’Univers, tu te rends compte ? Mais si cette chose
était là avant nous, n’est-ce pas, et que ce
serait nous, l’anomalie, alors qu’est-ce que
c’est que le monde, n’est-ce pas ? Sûrement pas
quelque chose de beau et de simple… Et si la nature
elle-même était une anomalie ? Une première
transgression cosmique à un ordre originel qui serait
l’atrocité même ? Si la vérité
première n’était qu’une masse de chair
indifférenciée, un morceau de matière informe
jeté dans le temps ? Et que nous ne serions que des
développements absurdes, inutilement raisonnables et
ordonnés, parlant une langue trop cohérente encore,
d’une loi première qui serait le chaos ? La danse de
viande ? En attendant le Mina a besoin de nos corps pour survivre,
de notre chair… Il n’est rien, sinon... Mais
peut-être qu’il n’est rien, au fond, notre
invention vraiment, une aberration, un ratage-golem, et nous
voilà aujourd’hui obligés pour je ne sais
quelle raison de le nourrir et de lui rendre quelque
causalité sans queue ni tête…
Pauvre Dolorès, pourquoi me dire ça ? Moi je venais juste prendre un café avec un jus de pamplemousse rose. Le café chaud, pensé-je en venant, est le lait des morts moderne. Plus de contrôle qu’un ange de Saint-Saëns. Ecoutant les histoires de Dolorès, ma pensée se perd. Je l’écoute, je l’aime. Mina, M.I.N.A., N.OV.A., N.E.G.M.A.. Comme d’habitude, ce sont eux qui ont les cartes et je préfère ne rien savoir. En attendant, Dolorès et moi sommes serrés comme des bêtes devant les images et dans la musique, depuis qu’elle s’est assise contre moi sur le fauteuil moite qui fait face au film. J’ai son crâne contre le mien ; je sens ce qui se passe dans son dedans. Sa machine cervicale parle et même trie des données affectives pendant ses mouvements d’humeur et ses différentes impulsions : temps des cœurs, âme rouge d’amour, elle, la machine, lui chuchote ses désirs de femme. Sa montre appuyée contre le dossier, bleue de désir, elle pense oui. Oui, pour moi. Elle veut coucher avec moi. Je tente d’oublier l’œuf et je joue au populaire connard. Quarante minutes plus tard je passe un bras autour d’elle, je lui parle, lui propose de partir dans un bar arabe, un long bar arabe dans le coin, avec une multitude de pièces successives. C’est un bar que je connais, mais, finalement, je crois que je l’ai inventé, ou n’y ai été qu’en rêve. Il ne peut en avoir d’aussi lumineux, la nuit, comme si le soleil l’habitait, et sa lumière éclairait les mosaïques vertes et beiges, les lignes dorées, les spirales noires des murs. Ainsi que tous les dessins qui l’illustrent et anticipent mes prochains voyages dans les souterrains de velours noir. Dans le bar dont je parle à Dolorès, alors qu’elle pose sa tête sur mon épaule et que je lui caresse les lèvres, je passe en vitesse les pièces du rez-de-chaussée et atteins l’ascenseur en bout de salle. Je m’endors pendant qu’il passe les étages (il y en a neuf mille neuf cent neuf) et rêve d’une explosion, le cercle N.O.V.A./N.E.G.M.A. dans une courbe irréversible, quelque part dans l’étouffante infinité du désert. « Et si Alice au Soudan avait raison ? » me demande Ita-Kamlel. Il parle dans ma tête, sa voix d’une impassibilité prodigieuse, et me dit de suivre Dolorès, ses longues jambes électriques, de lui demander de l’aide pour n’importe quoi, prendre même si nécessaire, l’excuse d’une traduction d’araméen, langue dont elle est la spécialiste. Je suis sous le joug de Kontrolle Nr.9, et, décidément, il n’y a rien à espérer d’autre. Dans le Guide pour se lever à la tombée du jour, Le Lait des Morts, il m’indique lentement les différentes mentions du Mina et le combat qui nous attend. Je suis dérangé et désemparé. Mais Dolorès, de l’autre côté, alors même que je me suis perdu dans mes pensées, me mordille le lobe de l’oreille gauche. Elle me le mordille depuis dix minutes, alors que le film a repris, et que, de nouveau, devant nous, défilent les premières images de campagne brûlante, la maison de la duchesse de ***, la petite fille et le bébé qui ne cesse de se transformer en courge de chair.
Je dois convaincre Dolorès de se tirer ailleurs au plus vite avec moi car le film dure depuis une heure et je sais maintenant qu’il ne s’arrêtera pas. Je lui demande de l’aide au sujet d’une information, lui raconte n’importe quoi. Nous commençons à nous embrasser et je lui effleure l’entrejambe humide. Elle est étonnée, sur le moment, Dolorès, que je désire lui toucher le sexe ici, dans le bar des Innocents, mais elle est gentille, elle accepte, ça ne la dérange pas qu’on nous voie comme ça ensemble. Alors je la masturbe avec douceur. Excitée et ivre, elle me murmure bien des choses... Je l’écoute, je l’aime... Mais je suis désespéré ce soir, c’est à cause de mon œuf, et tout cela à l’air beaucoup, beaucoup moins parfait que prévu, je sens la purulence de l’infection qui se répand le long de ma cuisse, alors que s’agite et halète Dolorès sur mes genoux.
*
* *
Nous traversons la rue Sainte-Justine jusqu’au pont des soupirs, et vers sept heures, nous sommes finalement dans son appartement. Dolorès est une poétesse plus ou moins bisexuelle (Diane aussi l’était - le nombre de mecs pourtant à leur tableau). Elle est maintenant déchaussée dans sa longue robe noire, avec sa violette fanée. Je lui attrape sa touffe de cheveux ; à mes yeux, ses cheveux ne cessent pas de pousser dans la pièce principale. Et Dolorès prend davantage et davantage de place, alors que mes yeux se plongent dans les détails de son corps. Une grande tristesse m’envahit. Par la fenêtre, nous voyons les rues de la ville. À nos yeux, celle-ci n’est plus qu’une excroissance de chair humaine et saignante en marche, la Meringue de Mina dont certains quartiers peut-être sont ce qui reste de Guy End et qui ne peut tout bonnement pas pourrir et disparaître, devenir cendres ou poussière, mais doit survivre dans un atroce rattachement de viande. Cependant, ce soir… Ce soir, les nuages sont des guépards qui annoncent que nous sommes, dans un ciel de sexe, elle et moi, le désir de toute la ville.
Je m’agrippe à ses
fesses et d’elle naîtra une pensée
d’enfance : Caroline Baltimore. Ce fut notre amoureuse
à tous les deux, avant son départ pour le sanatorium.
D’autres individus ont touché Dolorès avant
moi, et dans les couloirs souterrains de sa personnalité
(audible dans sa conversation parfaitement
déstructurée) s’enchaînent des sortes de
petites pièces aux lumières violettes et dans un
désordre total. En elle, elle me veut dans une
étrange chambre brûlée de son esprit, et
là-bas elle tente de retrouver les paroles du Mina.
C’est marron clair et de matière cervicale, elle a
là des meubles aux infinités de tiroirs, et quelque
part elle a bien dû ranger les mots en question. En
attendant, c’est un disque de musique noire, pas de doute,
qui se joue sur son lecteur... Elle commence à danser,
lentement, la tête en arrière, ses cheveux tombant sur
ses yeux, à la mesure des caresses, rames d’un navire
viking, elle sourit, porte son verre à ses lèvres. Je
la vois de tous les côtés et sous tous les angles
à la fois, Dolorès, elle prend toute la pièce
et mon regard est incapable de l’embrasser tout à
fait... Je saisis le bord de sa respiration alors plus lente, plus
appuyée et aux mélodies sinueuses et colorées,
je commence à lui caresser l’entrejambe à
nouveau et la détendre un peu plus dans un slow secret.
C’est là qu’elle me glisse en offrande sa langue
au goût de tarte de fraise couleur violette à la
destruction de tout repos.
– Il est là...
– Mais qui, lui ?
– Le Mina... Il nous attend... Il nous observe toujours... Il
m’a parlé une fois, tu sais...
– Qu’est-ce qu’il t’a dit ?
– Attends... Encore un baiser...
J’aimerais tant la protéger encore quelques instants du chien de viande, avant qu’elle n’explose ou ne se perde dans ce coin particulier de son cerveau... Elle est si belle et émouvante au son de l’air qui passe sur son lecteur, c’est comme si elle appartenait déjà au passé, comme si elle n’était qu’un hologramme que je me jouais pour me souvenir d’une époque comme ça... Misérable et touchante... Le ridicule a toujours été ce qu’il y a de plus proche de la beauté humaine... Ridicule, Dolorès ? Bien sûr, dansant comme ça, ni pour elle ni pour personne, ridicule et divine, c’est une sorte de sainte, comme son frère... Famille de saints... Alice au Soudan... Elle prend la guitare, maintenant elle va chanter Alice au Soudan...
Sa
notoriété
Sa trop grande beauté
Dans l’appartement de Dolorès, je pense Caroline Baltimore et la prend. Je n’ai plus un corps, mais un lambeau de chair saignante dont les yeux explosent. Mon érection est immédiate, créant comme de petites conserves de viande et de crème pâtissière entre nous, pour une multitude de nouvelles pièces initiatiques. Caroline Baltimore passe sur mes genoux, sa culotte pendant au bout de son pied droit, ses longs cheveux blonds cendrés, couleur de sable, caressant voluptueusement le sol de Dolorès. Un drap blanc la recouvre dans la pièce de plus en plus blanche. J’ai l’impression de vivre dans l’insupportable feuilleton, tissant la trame de mes rêves, celui qui s’infiltre par le sang. En imagination, j’entre dans Kontrolle Nr.9. Ma souffrance devient plus légère, mais je n’arrive pas à joindre Ita-Kamlel ni Guy End là-bas ; Guy et moi coupables comme morse et charpentier, tuant les filles qui nous brisaient le cœur, et parfois même tout l’immeuble...
Cette humiliation
Manque de compassion
Je reviens lentement à l’appartement. Caroline est maintenant tout à fait autonome à nous, assise en jupes sur le sol. Presque jeune noire américaine, presque Diane, Dolorès est à la guitare, absorbée par son chant, qu’elle chante pour Caroline ou pour moi.
M’empêchent de
dormir
Me font tant souffrir
– Il est temps de dîner et de boire, dit Dolorès.
Caroline se love sur moi et je rentre dans la chambre. Elle me masturbe, tout semble écrit ; ce pourrait être un grand livre entièrement placé derrière nous. Mon sexe est extrêmement réceptif à ce genre d’ambiance, cette tierce évocation qui créé une coupure de sens et fait que nous ne sommes pas deux lorsque nous sommes deux. Il faut absolument me blesser dans mes certitudes, entraîner une lente décomposition de tous mes membres. Lorsque je jouis, l’appartement devient transparent et je ne vois plus rien. Ma jouissance est un chant de sirène. Et Caroline est ce que j’éprouve et je sais ce qu’elle éprouve. Elle et moi sont elle. C’est absolument sans fin.
Mais pendant ce temps,
Dolorès a réussit à retrouver les mots du
Mina, et c’est un éclaboussement
d’évidence. Le Mina a même laissé
à l’humanité une lettre qui contient des
plaquettes de poèmes. J’en attrape une pour
l’observer de plus près : c’est la merde de
consciencieux élèves qui travaillent encore sur
l’amour spirituel, c’est-à-dire sur une jeune
fille dont ils ne se rappellent plus le visage.
– Je me souviens très bien de tout ça, me dit
Dolorès. Spot sur le tableau noir du
Lycée-Mathématiques. À quelques mètres
de là, les hommes du Mina croisent mon chemin et me hurlent
quelques paroles inintelligibles, comme assourdies et
dirigées vers d’autres bâtiments. Je croise Guy
End et lui dit le chien de viande qui nous dirige mais il se
contente de me caresser le visage, de me mordiller l’oreille,
de me peloter et de m’embrasser dans le cou pour me rassurer.
Il ne peut pas m’aider. Je ne peux pas l’aider. Nous
sommes si vains, nous sommes déjà vaincus. Il neige
et je me déplace avec agilité dans Sainte-Caroline.
À la fille du restoroute qui vient de m’embrasser, je
demande des nouvelles de l’opération de Caroline. Elle
est morte, dit-elle. Mais pas en moi, pensé-je. En moi, elle
vit, ses cheveux ne cessent pas de pousser. Ses cheveux blonds
coupés aux épaules, ses yeux noisette et son
sourire... Dis-moi… Dis-moi comment le Scorpion, le
nostalgique et nocturne Scorpion, aurait-il pu percer la lune de sa
queue et son goût de pâte de fruits ? Absurde. Le
sanatorium est une absurdité dans le destin de Caroline
Baltimore. Les lumières s’éteignent, il fait
alors si froid dans Sainte-Caroline. Là, je croise Guy End
à nouveau et lui dit que j’ai perdu mon âme. Sa
souffrance est insupportable.
Un drap blanc la recouvre comme la pulpe attendrie des yeux. Dolorès et moi glissons sur les graciles fesses d’argent poli de Caroline et dessus leur sillon, ombre de pas grande chose...
– Le Mina n’avait pas
besoin de me tuer, mais maintenant il le fera...
– Pourquoi ?
– Parce que maintenant je suis Caroline Baltimore...
– Caroline Baltimore ?
– Elle est morte, mais pas en moi ; en moi, elle vit, ses
cheveux continuent de pousser, comme lors de notre nuit
d’amour ensemble... Caroline Baltimore...
Elle me débraguette et passe
sa main, chante en russe pour faire tomber la nuit. Dolorès
a beaucoup bu. Vouée à l’échec, elle
devient Caroline Baltimore, héroïne défaite, son
visage blond contre mes épaules, ses seins dont les
tétons durcissent, ses jambes gainées de Nylon noir.
Elle me cogne violemment le crâne contre l’acier du
lit, me vide à un rythme frénétique et,
malgré les secousses, le poème continue de
s’écrire à la fraise de mercurochrome
mêlé de sang. Elle me demande ensuite encore de la
branler et de la lécher : ça n’est tellement
pas elle, Caroline Baltimore, agitée contre ma ceinture et
chantant des choses slaves, c’est une hallucination qui nous
découpe en morceaux, la brise et me blesse. Elle continue
les sirènes, je l’embrasse, avale ses cheveux qui
continuent de pousser, et le poème continue de
s’écrire à la destruction de tout le reste. Je
me dis que c’est très triste, terriblement inutile ce
qu’elle éprouve pour Caroline, ma terre promise et la
sienne automatiquement diluées dans les mares de
chagrin.
– Et tu ne crois toujours pas au complot, bien sûr,
même si la musique diagonale Alice au Soudan te fait
comme un tuyau de plomb qui te martèle le crâne.
Articulations étranges avec des figures
dépersonnalisées, leurs regards comme tous les autres
regards, ils t’entourent, ils ne sont pas morts. Ce pourrait
être très beau, très poème, bien
sûr, mais derrière, quand même, je te promets
qu’il y a le Mina, cette chair humaine saignante de forme
canine. La vicieuse sphère d’ennui a gagné de
toute éternité. Nous ne pouvons plus nous voir mais
seulement nous regarder. Et la disparition, c’est la
preuve...
Je lui demande bien de quoi elle se mêle : tout ce massacre volontaire manifeste, cette arme qui sous le nom du Mina nous dit de nous calmer, très doucement, et la disparition de Guy End. Mais progressivement il me semble qu’il y a une grande lumière dans la pièce de télévision ensanglantée, le seuil de son pied droit, les longs cheveux blonds cendrés de Caroline, couleur de petit-lait sous les maxillaires, stries jaune d’œuf sur le parquet d’acier. Maintenant elle va porter un pull kaki, un pantalon noir sur des collants noirs et des ombres jetées sur le tableau noir.
*
* *
Une fois habillée,
Dolorès me fiche dehors, car c’est l’aube
déjà et il va falloir y aller, se réveiller,
avancer dans le déluge dehors, toutes les
éclaboussures de viande qui créent ce rattachement de
chair, et pour moi pas même de café noir, pas de jus
de pamplemousse, pas d’ange, pas de sens. Je regarde
Dolorès, je mets mes bras autour d’elle, je
l’appelle une dernière fois « Caroline »
tandis qu’elle continue les sirènes et les cheveux
blonds cendrés recommencent à pousser, je
l’embrasse, avale ses cheveux, elle me parle, me rappelle que
c’est une manière de bébé hypnose qui
nous découpe en morceaux, la brise et me blesse. Et à
ce moment, près de son crâne, je sais ce qu’elle
pense :
« Il est prêt à agir, il va faire du grabuge,
vite... »
Elle porte le pendentif coquille
d’escargot Alice au Soudan comme dans mon
rêve, je l’agrippe, l’observe et elle me dit que
c’est un code génétique alternatif entre
Caroline et elle. Elle ne l’a pas choisi, il lui a
été imposé.
– Et pourquoi crois-tu qu’ils ont choisi Caroline,
justement ?
Pour moi, probablement. Et si Dolorès n’était même pas intéressée par Caroline ? Si elle n’avait finalement été mon amoureuse qu’à moi ? Et si l’histoire avait été imposée à Dolorès, avec le pendentif code génétique, pour qu’elle donne un sens plus pur à ses transformations ? Alors il faudrait retrouver le dit Mina, histoire de bien savoir de quoi il en retourne. Et comprendre enfin ce qui se passe, putain, à Sainte-Caroline.
Dolorès a refermé la porte. Je suis désormais tout à fait seul. Je marche alors dans les rues de la ville, passe les immeubles en ruines, partout c’est presque le désert… Tout finira donc par disparaître, et il n’y aura plus ni politique, ni religion, ni télévision, ni sport ni sexe. Tout ça n’est rien devant les astres, à la fin, si c’est la mort qui gagne. Dans ma tête, médiatisé par Ita-Kamlel, j’entends bien, inscrit au stylet couleur fraise presque transparent : « Le Mina est une nouvelle forme, médiane, du spectacle amoureux. » J’aurais aimé, tu le sais, j’aurais cru, j’aurais voulu, mais maintenant ce ne sont que des pétales de sentiment. Fleurs de feu, mines de rien. C’est trop triste. La première sensation est seule maintenant.
Maintenant... Quelques rides semblables à des nervures, très jeunes, sèches, dans les plus sombres recoins de Sainte-Caroline... Désuétudes, passe-temps bourgeois, ennuis mordorés... Et toutes ces cigarettes que je continue bêtement à fumer… Le désert urbain, dans sa spatialité écrasante, est maintenant pénétrant d’intimité... Et si le désert de chair est bien veine de leurs yeux atomiques explosant dans une otite irréversible, sous hypnose, le Mina, ses polices pseudo cycliques ne seront même pas le merry-go-round des choses. Parfois je me demande si ce que je dis veux encore dire quelque chose autrement que pour moi. Pourtant je n’ai pas le choix. Je ne peux pas le dire autrement. La grammaire s’est tirée avec Dieu. C’est le drame sang sur le sol bleu. Autrement je saurais, et d’ailleurs j’ai déjà essayé... Ita-Kamlel me l’a dit : Je suis voué à des actes seuls, avec un minimum de signification et un maximum d’immédiateté. C’était écrit.
Enfin, je regarde derrière moi les premières lueurs du jour, poussières... Je n’ai plus un corps, mais un lambeau de chair et de parcelles d’âme des manques de la soirée... Le poème s’était écrit de lui-même : Alice au Soudan, le Livre pour se lever à la tombée du jour, entre vos mains, votre lait des morts estampillé Kontrolle Nr. 9, marque déposée, produit contrôlé : À la fraise de la femme comme une énorme blessure infectée.
Je tourne la tête à
deux fois. Je suis au cœur de Sainte-Caroline, place
Sainte-Antènoëlle, au croisement de la rue
Sainte-Justine, à droite du
Lycée-Mathématiques, et il y a là quelque
chose que je ne connaissais pas. C’est une sorte de statue
vivante de chair humaine de treize mètres de haut. Elle est
fixe mais elle ne semble pas statique pour autant. Au repos,
plutôt, avec une allure, comme ça, de grand chien dont
le sang ne cesse de circuler. C’est le Mina, bien sûr,
je ne peux plus douter. Il m’observe. Peut-être que
Dolorès disait vrai... Peut-être que c’est ce
qui me fout en l’air, moi et ma pensée et mes mots qui
sans cesse se barrent en couille… Mais peut-être aussi
est-ce seulement une impression ? Je regarde une vieille femme au
loin. Elle hurle :
– Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous et comment
faites-vous pour ne pas nourrir le Mina ?
Je vois que le Mina hélas m’observe toujours... Il se lève presque au centre de la place Sainte-Antènoëlle, mais, encore une fois, il est au repos et, de nouveau, il ne bouge pas... Quelle horreur... Quelle carambouille sorcière de mille bordels... Quel con... Après un sursaut de frayeur, je me détache de la place cœur de Mina et je cours dans un tea-room insupportable. Je suis encore là. Je suis encore mon corps. Je demande un café avec un jus de pamplemousse rose et il n’y a que des vieilles dames ici, mis à part la belle serveuse métisse au long visage de Diane qui longe les tables comme une gracieuse panthère musicale. À mes yeux, elle ne cesse pas de venir d’une pièce de télévision de plus en plus blanche.
Alors je fuis, passe par bien des rues vides, tristes, du centre de Sainte-Caroline, pour arriver jusqu’à un hall d’immeuble en ruine, avec de vieilles boites aux lettres aux noms dont les dernières lettres se fissurent, parfois carrément les syllabes finales se perdent. Un escalier dont les dernières marches perceptibles sont en train de tomber en ruine, escalier vers nulle part... Est-ce qu’ils sont tous en train de se dissoudre, de s’effacer, avec des identités de plus en plus improbables ? Une musique vient du premier étage, une chose étrange et un rien irritante, mais soudain nostalgique... C’est la voix de Dolorès, de plus en plus jeune, noire et morte avant, chantant Alice au Soudan.
Mais quand je suis loin
Loin de tout potin
Je sors un mouchoir de poche, me le passe contre le front. Il est brûlant. C’est cette migraine à faire frire le bacon, et mon œuf qui ne cesse de grossir, mais enfin, je suis arrivé là, c’est le bout du jour, je ne peux plus et je ne veux plus aller nulle part...
Je me dis franchement
Pensons largement
Un crissement de porte. C’est
un maigre vieillard qui sort d’une porte
dérobée, il vient de là-bas, en robe de
chambre, et il va vers une boite aux lettres au nom illisible. Il
doit être médecin, je vois ça à ses
mains. L’homme tourne la tête et me fait face. Je
m’approche de lui, boitant un peu.
– Professeur Thomas ?
L’homme ne répond pas.
Il est fasciné, semble-t-il, tout à fait
obnubilé par ma façon de marcher, si
irrégulière, bancale, boiteuse.
– Qu’est-ce qui ne va pas avec vous, jeune homme ?
– Je ne sais pas trop. C’est une sorte
d’infection entre la jambe et le testicule qui a pris de trop
grandes proportions, voyez... On dirait un œuf. Un
médecin m’a dit que c’est un genre
d’œuf de chair malade. Et ma grand-mère pense
que je suis enceint...
Le professeur Thomas fait non de la
tête. Je baisse mon pantalon, lentement il m’ausculte
et dit :
– Ca n’est pas un œuf, jeune homme, je le sais.
C’est ce qui vous protège de la disparition, et cela
s’appelle un écrisson.
– Ca fait très mal, vous savez... Je ne peux pas
l’enlever ?
– Mmm... Je ne vous le conseille pas, jeune homme, je ne vous
le conseille pas du tout. Voyez, si j’étais vous, je
m’accrocherais même à cet
écrisson avec les dents. C’est une arme que
vous avez là, jeune homme.
Je remercie le professeur Thomas et retourne au désert de chair, parmi les derniers immeubles en ruine, les gymnases, stades, églises, bâtiments scolaires et bars décomposés, et, au milieu des spectres, ne faisant qu’un avec leur chœur, je ne peux m’empêcher de chanter :
Qui est
Alice
Au Soudan ?
Je quitte finalement Sainte-Caroline décomposée. Pas loin du stade et des cabines, à l’extrême frontière, sous une lumière aveuglante et glaciale, il y a Dolorès en vélo devant moi qui se retourne et me hurle : « Je sais ce que j’éprouve. » Et dans le cœur de son pendentif, Alice au Soudan, code génétique alternatif, matrice de mauvais rêves, je lis l’étendue de son drame, et du mien, l’ensemble du corps de Caroline Baltimore devenu grille de contrôle nerveux. Cette souffrance est insupportable. D’un instant à l’autre, si je perds mon écrisson, je me refondrais dans la matière noire d’où naissent les ombres. Kontrolle Nr.9. Mais à cet instant, dans cette ville sur le point de disparaître et pour quelques secondes encore, je peux entendre les voix, les cris, les timbres encore distincts de toutes les âmes de la commune, et dans le chœur que les voix forment, s’ajustant les unes aux autres, il n’y a plus que l’ultime effort, la dernière corde audible de l’homme qui a oublié le chemin. Il répète, rayé, inlassablement la même eau du fleuve, les mêmes phrases que je serais idiot de redire, les mêmes formules liturgiques, poétiques, les routines qui alimentèrent, comme le cours des saisons, sa vie jusqu’à ce jour. C’est Alice au Soudan ; c’est une passion. Les chœurs hurlent pour leur délivrance. On croirait un orage de larmes. Et je vois que déjà beaucoup de gens qui étaient encore vivants sont ce qu’on appelle morts.