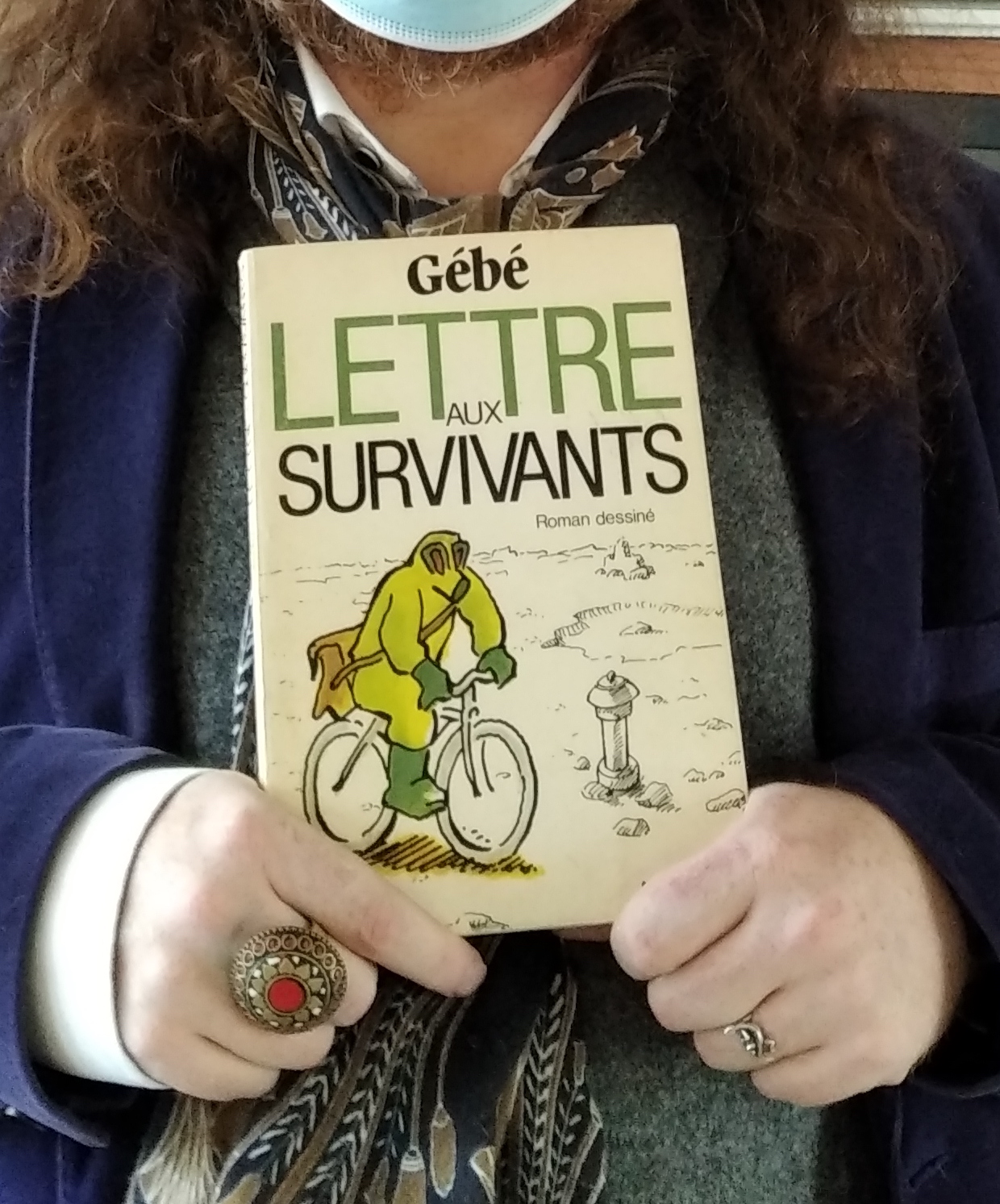Paru en 2020
Contexte de parution : Le livre sans visage
Présentation :
Texte publié le 23 octobre 2020
Je me souviens des journées passées à réaliser ce clip, avec Thomas Bertay, pour une amie commune. C’était dans les locaux de Sycomore Films de la rue des Apennins, en août 2002. Le temps était ralenti comme un travelling au milieu d’un film noir. Notre amie avait le cœur brisé ; elle mettait fin à une histoire d’amour qui avait duré vingt ans. Et les images de son clip étaient des souvenirs de cet amour. Lorsque nous finissions nos séances de travail, elle allait au coin de la rue chercher des victuailles qu’une mystérieuse voiture lui apportait : des sacs remplis de pates, de tomates, de courgettes, de persil, d’huile d’olive, de fromages, de vins. Et Thomas se mettait à cuisiner pendant que notre amie faisait des imitations pour nous faire rire. Par moments, lorsque la soirée laissait place à la nuit, nous nous tenions la main comme des cousins qui vivaient ensemble leur dernière soirée de vacances et regardions ensemble toutes les images qui s’animaient face à nous. Devant des films amateurs datant de des années quatre-vingt, Thomas faisait remarquer l’extrême tristesse de son regard et son sourire mélancolique. Et notre amie répondait : « C’est normal. Je venais de la rencontrer. Et je savais que notre histoire était sans avenir. »
Je savais que mon histoire avec les réseaux sociaux était sans avenir. Mais ce sont les histoires sans avenir qui durent le plus longtemps. Les histoires sans avenir durent même beaucoup plus longtemps que celles qui sont destinées à durer. Tout d’abord, parce qu’on en attend quelque chose qui n’arrive pas. Ensuite, parce qu’on a investi trop de temps et d’énergie en elles pour partir tout de suite. Enfin, parce qu’on pense qu’on a vécu tellement longtemps ensemble qu’on n’arrivera jamais à vivre seul. Deux semaines après avoir décroché « cold turkey » de Facebook, je ne me demande pas si j’ai bien fait de quitter les réseaux sociaux. Là, comme dirait l’autre : la question, elle est vite répondue. Ce que je me demande, c’est si je les ai vraiment quittés. Et la réponse est non. Non, je n’ai pas encore quitté les réseaux sociaux.
Dans mon cœur, je veux dire.
Je n’ai pas encore quitté les réseaux sociaux, puisque je vis encore avec leur empreinte, leur réflexes, leur esprit. Je m’en doutais. On ne quitte jamais complètement Facebook. On commence simplement à mettre des pouces bleus sur des cartes de resto, des photos de magazines, des génériques de fin d’épisodes de série ou des pages de romans en cours de lecture. On fait un cœur en courbant nos doigts à la jeune fille qui nous sourit de l’autre côté de la rue. On met des hashtags dans les phrases qu’on prononce à la caissière du supermarché.
Il me faudra beaucoup plus que deux semaines pour me débarrasser de tous les tics que j'y ai contractés. En particulier, la pire addiction pour un essayiste : l’addiction au buzz. La recherche de l’effet à tout prix, la volonté de viralité, le désir que « tout le monde en parle ». Cette recherche de l’intensité dans la réaction produite, cette quête de l’effet, du buzz, peut apparaître chez à peu près tout le monde, mais elle se fait toujours au prix de l’honnêteté dans la réflexion ou de la nuance dans l’exposition.
C’est quelque chose qui préexistait à Facebook, puisque c’est le noyau de la polémique littéraire et journalistique depuis au moins un siècle et demi : à l’époque où les hommes portaient des lorgnons. Mais c’est quelque chose que les réseaux sociaux ont amplifié, au point de rendre impossible toute nuance intellectuelle dans le débat public. Le recul, le refus de réagir ou de donner son avis trop vite, le refus de prendre parti à tout prix et d’attendre de bien peser le pour et le contre, la volonté de reconnaître les qualités d’un adversaire intellectuel, y sont toujours assimilés à de la lâcheté. Au point qu’on peut dire, encore une fois, que nous n’avons jamais quitté la cour d’école, avec le petit qui se fait maltraiter par la grande gueule méchante. Le pamphlet est le terrain de jeu des brimeurs et des harceleurs. Les plateaux télés sont les rings de boxe des brimeurs et des harceleurs. Et finalement les réseaux sociaux, qu’on croyait la terre promise des timides, sont devenus un lieu d’occupation supplémentaire pour les brimeurs et les harceleurs. Brimade partout, justice nulle part.
On peut repenser à l’opposition des Shit et des Johnson chez William Burroughs. Le Johnson est celui qui s’occupe de ses affaires, le Shit est celui qui se mêle sans cesse de ce qui ne le regarde pas. Le Johnson est digne et droit et demande simplement qu’on lui fiche la paix : « Ce n’est pas une personne malveillante, fouineuse, querelleuse, qui créé des problèmes. » Le Shit est un faiseur d’histoires. Il a le nez dans vos oignons et une main dans chacune de vos poches. Il n’y a pas besoin d’être Prix Nobel de physique pour comprendre que le Shit est comme un poisson dans l’eau des réseaux sociaux. Il intervient sur le mur de tout le monde. Il vient faire sa crotte dans les commentaires des posts du Johnson. Il vient faire sa crotte sous les photos du Johnson. Il tague le Johnson dans son texte tout pourri jusqu’à ce que le Johnson, épuisé par son harcèlement intellectuel, le bloque. Après quoi le Shit hurle à la censure, l’accuse de tous les maux, l’associe plus ou moins adroitement aux combats politiques en cours et tente d’en faire, bon an mal an, la victime collatérale d’une future « shit storm » ou d’une guerre médiatique en cours.
La triste vérité dont les réseaux sociaux sont une des multiples expressions, c’est que ce monde n’appartient pas aux Johnson. Il appartient aux Shit. Le Shit est un milliard de fois plus efficace que le Johnson dans à peu près tous les domaines. Sa vulgarité, son indiscrétion, son opiniâtreté lui rapportent un maximum tandis que la droiture du Johnson est un constant handicap dans son parcours professionnel et social. Regardez autour de vous. Regardez qui obtient de vous ce qu’il veut : à part si votre exigence est très haute, et votre psychologie très subtile, c’est presque toujours celui qui insiste le plus. La classe est un luxe qu’on se donne. Ce qui marche, c’est la vulgarité. L'élégance, c’était bon pour avant-hier, à l'époque où les hommes portaient des montres à gousset.
Quand j’ai annoncé que je quittais les réseaux sociaux, je n’ai pas pris le temps de lire toutes les réactions. Je me suis dit que si je commençais à réfléchir à ce qu’on m’y disait, j’y serai encore douze ans plus tard : comme Ulysse qui mit autant de temps à rentrer à Ithaque qu’à combattre à Troie. Mon but n’était pas de ralentir le moment de mon départ, mais au contraire de l’annoncer le plus clairement possible, puis de me casser très vite aussitôt après. Cependant, j’ai quand même, par « mystique de l’esprit critique », essayé de prendre avec moi quelques retours négatifs qui pourraient me servir de matière à réflexion.
Si je mets de côté les habituelles petites saletés de nuit des trolls et autres cafards internautiques, j’ai quand même repéré deux commentaires qui avaient, sinon une réelle valeur, du moins un authentique contenu.
Un premier gars m’a dit : « Quand on quitte les réseaux sociaux, on s’en va sans rien dire. Si on veut en parler, c’est qu’on cherche l’attention. Tu veux encore des pouces bleus. »
Un second gars a dit : « Ce qui se passe est exactement l’inverse de ce que tu prétends. Tu penses que les réseaux sociaux ont cessé d’être opérants. En réalité, ils ne commencent vraiment que maintenant. Maintenant, quelque chose est en train d’avoir lieu, et c’est symptomatique de ta part de te casser juste au moment où c’est en train de bouger. Hier, tu aurais sans doute pu t’en passer. Plus maintenant. Maintenant, plus rien n’aura lieu sans. »
Ce sont deux idées intéressantes, qu’elles soient vraies ou fausses.
Le premier gars exprime l’idée que de vouloir publiquement expliquer son geste revient toujours à chercher de l’attention. Il est dans une image du monde qui a été nourrie intégralement par les réseaux sociaux et la télévision : l’idée que les hommes n’agissent ou ne pensent que pour qu’on parle d’eux. Il présuppose donc que c’est l’alpha et l’oméga de toute expérience humaine, et qu’on peut vraiment passer une semaine à écrire un texte uniquement pour qu’on « parle de nous » pendant une heure. Je n’ai aucunement l’envie ici de justifier le fait d’avoir écrit « pourquoi je quitte les réseaux sociaux », mais j’ai très envie d’interroger l’idée que tout puisse être réduit à la question du buzz. Ca fait vraiment partie du mal, ou de la merde, que transmettent les réseaux sociaux.
Le deuxième gars pense que « tout » désormais va se jouer dans les réseaux sociaux, et que, dès lors, c’est nécessairement l’endroit où il faut être. C’est un peu comme ces personnes qui disent : il est impossible de faire de la politique sans être membre d’un parti politique. Le gars ne semble pas pouvoir imaginer qu’on puisse avoir une lutte à mener « en dehors » des réseaux sociaux parce que, en réalité et en profondeur, on pense que les réseaux sociaux font partie du problème, et non de la solution.
Car oui, je pense que les réseaux sociaux font partie du problème. Je pense qu’ils sont une loupe grossissante du problème. Je pense qu’ils sont un symptôme du problème et je pense qu’ils sont une allégorie du problème. Avoir quitté les réseaux sociaux n'était pour moi qu'une étape préalable pour commencer à réfléchir sur ce qu’ils sont. Exactement comme je n’ai pas pu écrire sur le sickamour sans avoir aimé, et sans avoir quitté, et sans avoir passé de longues années à en être encore malade, je ne pourrais écrire réellement sur les réseaux sociaux que lorsque je m’en serai vraiment détaché. Lorsque je serai enfin loin d’eux, mais aussi loin de là où je suis désormais. On ne commence à penser vraiment que lorsqu’on est loin de quelque chose, mais loin également de là où on est allé se réfugier quand on en est parti. Ce n’est jamais l’amour qui suit le sickamour qui nous guérit du sickamour, c’est l’amour d’encore après. Quand on aime, il faut partir deux fois.