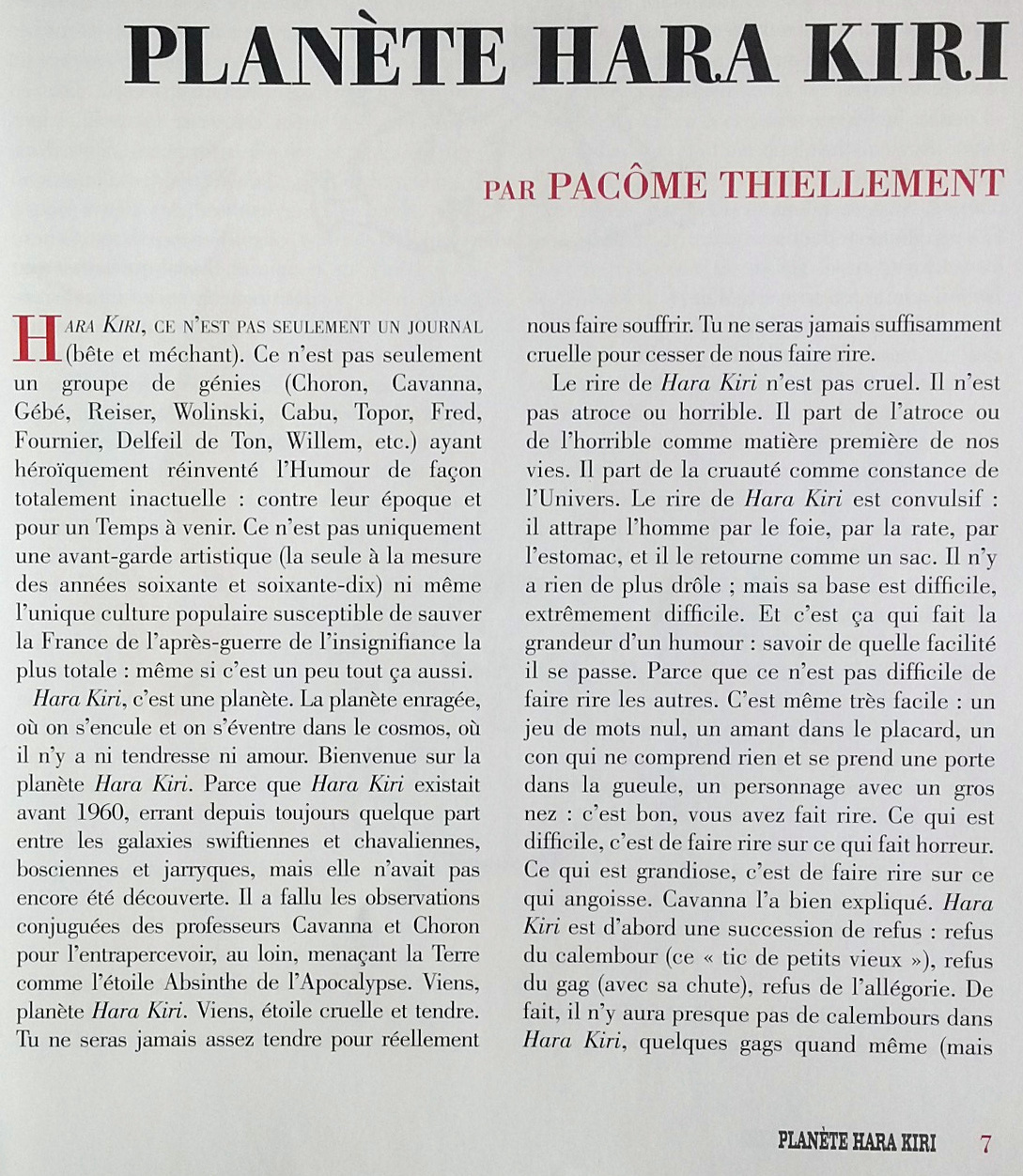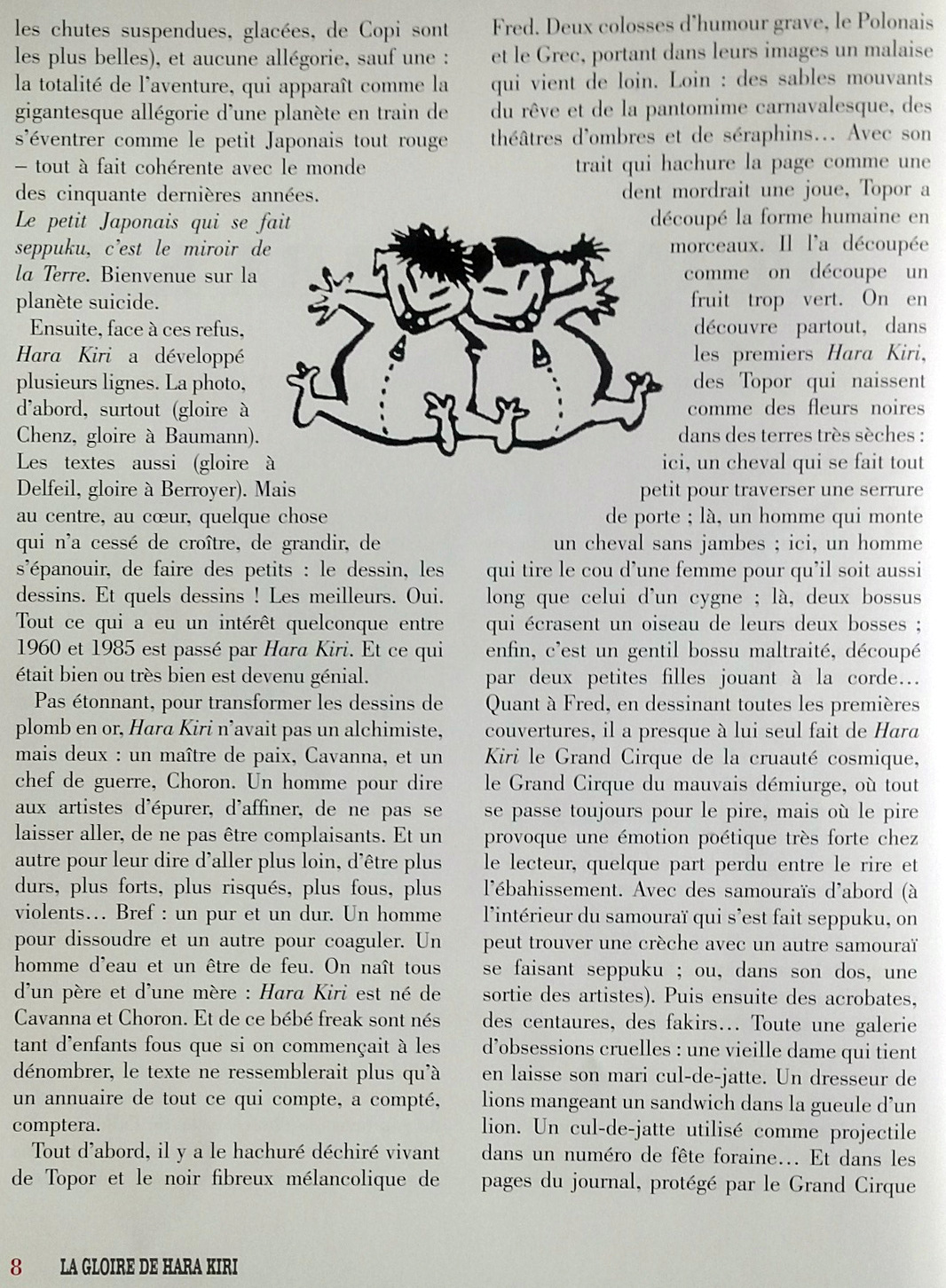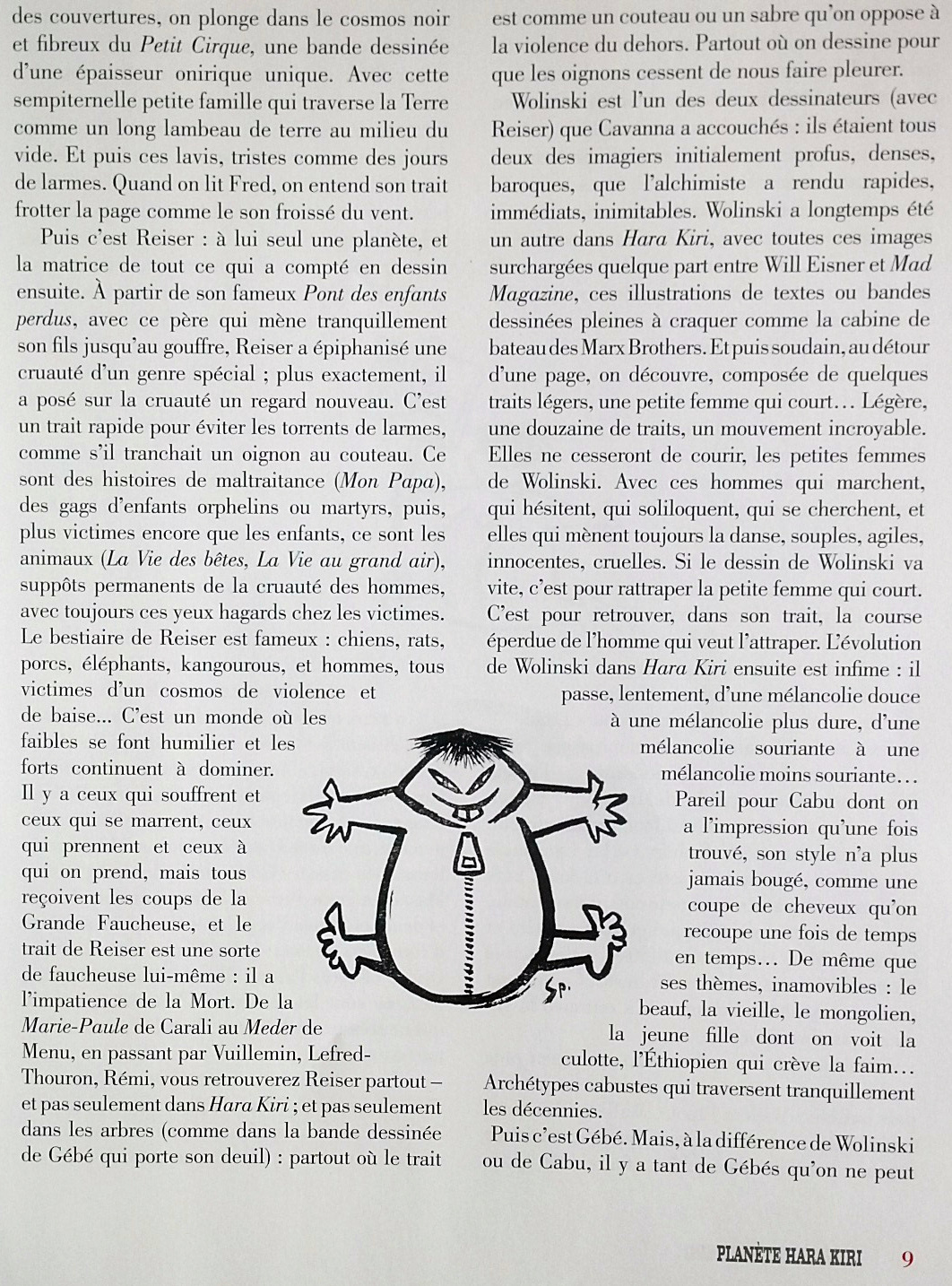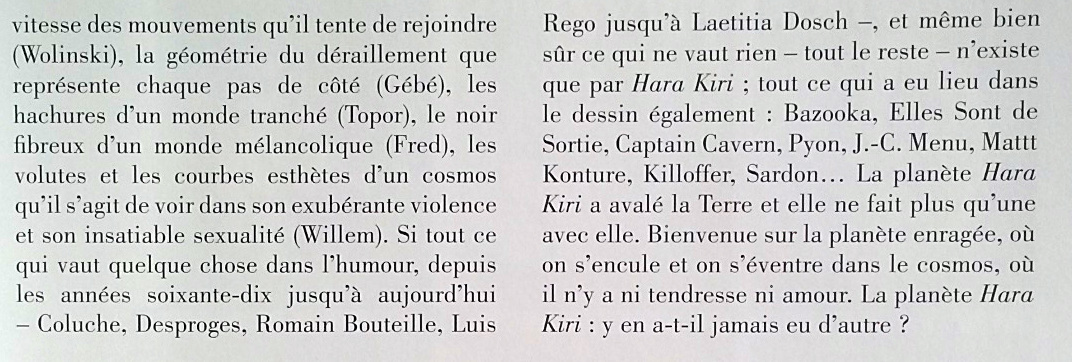Paru en 2013
Contexte de parution : La gloire de Hara-Kiri (Glénat)
Présentation :
Préface de La gloire de Hara-Kiri, anthologie de dessins parus dans Hara-Kiri.
Sujet principal :
Cité(s) également :
Hara-Kiri, ce n’est pas seulement un journal (bête et méchant). Ce n’est pas seulement un groupe de génies (Choron, Cavanna, Gébé, Reiser, Wolinski, Cabu, Topor, Fred, Fournier, Delfeil de Ton, Willem, etc.) ayant héroïquement réinventé l’Humour de façon totalement inactuelle : contre leur époque et pour un Temps à venir. Ce n’est pas uniquement une avant-garde artistique (la seule à la mesure des années 60 et 70) ni même l’unique culture populaire susceptible de sauver la France de l’après-guerre de l’insignifiance la plus totale : même si c’est un peu tout ça aussi.
Hara-Kiri, c’est une planète. La planète enragée, où on s’encule et on s’éventre dans le cosmos, où il n’y a ni tendresse ni amour. Bienvenue sur la planète Hara-Kiri. Parce que Hara-Kiri existait avant 1960, errant depuis toujours quelque part entre les galaxies swiftiennes et chavaliennes, bosciennes et jarryques, mais elle n’avait pas encore été découverte. Il a fallu les observations conjuguées des professeurs Cavanna et Choron pour l’entrapercevoir, au loin, menaçant la Terre comme l’étoile Absinthe de L’Apocalypse. Viens, planète Hara-Kiri. Viens étoile cruelle et tendre. Tu ne seras jamais assez tendre pour réellement nous faire souffrir. Tu ne seras jamais suffisamment cruelle pour cesser de nous faire rire.
Le rire de Hara-Kiri n’est pas cruel. Il n’est pas atroce ou horrible. Il part de l’atroce ou de l’horrible comme matière première de nos vies. Il part de la cruauté comme constance de l’Univers. Le rire de Hara-Kiri est convulsif : il attrape l’homme par le foie, par la rate, par l’estomac, et il le retourne comme un sac. Il n’y a rien de plus drôle ; mais sa base est difficile, extrêmement difficile. Et c’est ça qui fait la grandeur d’un humour : savoir de quelle facilité il se passe. Parce que ce n’est pas difficile de faire rire les autres. C’est même très facile : un jeu de mots nul, un amant dans le placard, un con qui ne comprend rien et se prend une porte dans la gueule, un personnage avec un gros nez : c’est bon, vous avez fait rire. Ce qui est difficile, c’est de faire rire sur ce qui fait horreur. Ce qui est grandiose, c’est de faire rire sur ce qui angoisse. Cavanna l’a bien expliqué. Hara-Kiri est d’abord une succession de refus : refus du calembour (ce « tic de petits vieux »), refus du gag (avec sa chute), refus de l’allégorie. De fait, il n’y aura presque pas de calembours dans Hara-Kiri, quelques gags quand même (mais les chutes suspendues, glacées, de Copi sont les plus belles), et aucune allégorie, sauf une : la totalité de l’aventure, qui apparaît comme la gigantesque allégorie d’une planète en train de s’éventrer comme le petit japonais tout rouge – tout à fait cohérente avec le monde des cinquante dernières années. Le petit japonais qui se fait seppuku, c’est le miroir de la Terre. Bienvenue sur la planète suicide.
Ensuite, face à ces refus, Hara-Kiri a développé plusieurs lignes. La photo, d’abord, surtout (gloire à Chenz, gloire à Baumann). Les textes aussi (gloire à Delfeil, gloire à Berroyer). Mais au centre, au cœur, quelque chose qui n’a cessé de croître, de grandir, de s’épanouir, de faire des petits : le dessin, les dessins. Et quels dessins : Les meilleurs. Oui : Tout ce qui a eu un intérêt quelconque entre 1960 et 1985 est passé par Hara-Kiri. Et ce qui était bien ou très bien est devenu génial.
Pas étonnant, pour transformer les dessins de plomb en or, Hara-Kiri n’avait pas un alchimiste, mais deux : un maître de paix, Cavanna, et un chef de guerre, Choron. Un homme pour dire aux artistes d’épurer, d’affiner, de ne pas se laisser aller, de ne pas être complaisant. Et un autre pour leur dire d’aller plus loin, d’être plus dur, plus fort, plus risqué, plus fou, plus violent… Bref : un pur et un dur. Un homme pour dissoudre et un autre pour coaguler. Un homme d’eau et un être de feu. On naît tous d’un père et d’une mère : Hara-Kiri est né de Cavanna et Choron. Et de ce bébé freak est né tant d’enfants fous que si on commençait à les dénombrer, le texte ne ressemblerait plus qu’à un annuaire de tout ce qui compte, a compté, comptera.
Tout d’abord, il y le hachuré déchiré vivant de Topor et le noir fibreux mélancolique de Fred. Deux colosses d’humour grave, le Polonais et le Grec, portant dans leurs images un malaise qui vient de loin. Loin : des sables mouvants du rêve et de la pantomime carnavalesque, des théâtres d’ombres et de séraphins… Avec son trait qui hachure la page comme une dent mordrait une joue, Topor a découpé la forme humaine en morceaux. Il l’a découpé comme on découpe un fruit trop vert. On en découvre partout, dans les premiers Hara-Kiri, des Topor qui naissent comme des fleurs noirs dans des terres très sèches : Ici un cheval qui se fait tout petit pour traverser une serrure de porte ; là un homme qui monte un cheval sans jambes ; ici un homme qui tire le cou d’une femme pour qu’il soit aussi long que celui d’un cygne ; là deux bossus qui écrasent un oiseau de leurs deux bosses ; enfin c’est un gentil bossu maltraité, découpé par deux petites filles jouant à la corde… Quant à Fred, en dessinant toutes les premières couvertures, il a presque à lui seul fait de Hara-Kiri le Grand Cirque de la cruauté cosmique, le Grand Cirque du mauvais démiurge, où tout se passe toujours pour le Pire, mais où le Pire provoque une émotion poétique très fort chez le lecteur, quelque part perdu entre le rire et l’ébahissement. Avec des samouraïs d’abord (à l’intérieur du samouraï qui s’est fait seppuku, on peut trouver une crèche avec un autre samouraï se faisant seppuku ; ou, dans son dos, une sortie des artistes). Puis ensuite des acrobates, des centaures, des fakirs… Tout une galerie d’obsessions cruelles : Une vieille dame qui tient en laisse son mari cul-de-jatte. Un dresseur de lion mangeant un sandwich dans la gueule du second. Un cul-de-jatte utilisé comme projectile dans un numéro de fête foraine… Et dans les pages du journal, protégé par le Grand Cirque des couvertures, on plonge dans le cosmos noir et fibreux du Petit cirque : Une bande dessinée d’une épaisseur onirique unique. Avec cette sempiternelle petite famille qui traverse la Terre comme un long lambeau de terre au milieu du vide. Et puis ces lavis : tristes comme des jours de larmes. Quand on lit Fred, on entend son trait frotter la page comme le son froissé du vent.
Puis c’est Reiser : à lui seul une planète, et la matrice de tout ce qui a compté en dessin ensuite. A partir de son fameux Pont des enfants perdus, avec ce père qui mène tranquillement son fils jusqu’au gouffre, Reiser a épiphanisé une cruauté d’un genre spécial ; plus exactement, il a posé sur la cruauté un regard nouveau : C’est un trait rapide pour éviter les torrents de larmes, comme s’il tranchait un oignon au couteau. Ce sont des histoires de maltraitance (Mon Papa), des gags d’enfants orphelins ou martyrs, puis, plus victimes encore que les enfants, ce sont les animaux (La vie des bêtes ; La vie au grand air), suppôts permanents de la cruauté des hommes, avec toujours ces yeux hagards chez les victimes. Le bestiaire de Reiser est fameux : chiens, rats, porcs, éléphants, kangourous, et hommes, tous victimes d’un cosmos de cruauté pure, mélange de violence et de baise... C’est un monde où les faibles se font humilier et les forts continuent à dominer. Il y a ceux qui souffrent et ceux qui se marrent, ceux qui prennent et ceux à qui on prend, mais tous reçoivent les coups de la Grande Faucheuse, et le trait de Reiser est une sorte de faucheuse lui-même : Il a l’impatience de la Mort. De la Marie-Paule de Carali au Meder de Menu, en passant par Vuillemin, Lefred-Thouron, Rémi, vous retrouverez Reiser partout – et pas seulement dans Hara-Kiri ; et pas seulement dans les arbres (comme dans la bande dessinée de Gébé qui porte son deuil) : partout où le trait est comme un couteau ou un sabre qu’on oppose à la violence du dehors. Partout où on dessine pour que les oignons cessent de nous faire pleurer.
Wolinski, comme Reiser , est l’un des deux dessinateurs que Cavanna a accouché : C’étaient tous les deux des imagiers initialement profus, denses, baroques, que l’alchimiste a rendu rapides, immédiats, inimitables. Wolinski a longtemps été un autre dans Hara-Kiri, avec toutes ces images surchargées quelque part entre Will Eisner et Mad Magazine, ces illustrations de textes ou bandes dessinées pleines à craquer comme la cabine de bateau des Marx Brothers. Et puis soudain, au détour d’une page, on découvre, composée de quelques traits légers, une petite femme qui court… Légère, une douzaine de traits, un mouvement incroyable. Elles ne cesseront de courir, les petites femmes de Wolinski. Avec ces hommes qui marchent, qui hésitent, qui soliloquent, qui se cherchent, et elles qui mènent toujours la danse, souples, agiles, innocentes, cruelles. Si le dessin de Wolinski va vite, c’est pour rattraper la petite femme qui court. C’est pour retrouver, dans son trait, la course éperdue de l’homme qui veut l’attraper. L’évolution de Wolinski dans Hara-Kiri ensuite est infime : il passe, lentement, d’une mélancolie douce à une mélancolie plus dure, d’une mélancolie souriante à une mélancolie moins souriante… Pareil pour Cabu dont on a l’impression qu’une fois trouvé, son style n’a plus jamais bougé, comme une coupe de cheveux qu’on recoupe une fois de temps en temps… De même que ses thèmes, inamovibles : le beauf, la vieille, le mongolien, la jeune fille dont on voit la culotte, l’éthiopien qui crève la faim… Archétypes cabustes qui traversent tranquillement les décennies.
Puis c’est Gébé. Mais, à la différence de Wolinski ou de Cabu, il y a tant de Gébés qu’on ne peut pas en parler autrement qu’au pluriel. Gébées sont ces images cruelles (la cartouche manufrance qui ne défigure pas ; la consigne des malles sanglantes). Gébées sont ces bandes dessinées proche des enquêtes comportementales : on a une idée, on la teste, on observe les résultats, on dresse un constat. Gébés ces « films à faire » que sont ses grandes bandes dessinées (L’An 01, Tout s’allume, Lettre aux survivants) continuées en nouvelles, en feuilletons. Avec son trait géométrique et déviant, le déraillement gébéen touche tous les thèmes mais surtout il en métamorphose toutes les formes. Et son pas de côté engendre beaucoup de pages à la construction-destruction inexplicable : des déviances à la cruauté lente comme les exploits de Berck, des histoires à l’envers (un genre gébéen particulièrement testé dans les vieux Hara-Kiri), d’autres comme des rêveries érotiques (En Mai j’ai pleuré ; il a beaucoup plu aussi), d’autres encore, comme L’escarpolette ou L’âge de fer, où la délicatesse du suranné se confronte à la violence froide de la modernité… Parfois Gébé est même capable de faire une double page, avec un côté noir et blanc (Blondinette dodue) et un côté couleur (La Langouste mayonnaise) et qui est tout ça à la fois : faux reportage, film à faire, enquête comportementale, pas de coté, rêverie érotique et humour bête et méchant. Mais Gébé, à la différence des autres Titans du Square – Reiser, Wolinski, Cabu – est sans continuateur. Personne n’a retrouvé la clé de sa parade sauvage.
Enfin il y a celui qui est arrivé un peu plus tard mais qui a été institué comme un pilier à part entière : Willem l’Inouï. Willem l’Unique : cosmos de sexe dans lequel quelque suprême démon humain plonge sa fourchette pour dévorer les êtres. Willem, c’est un trait souple, d’une élégance années 30, art nouveau et art déco, qui relie par ses courbes tous les éléments les plus déplaisants de la réalité. C’et un trait qui est comme un unificateur de substance sous les volutes esthètes d’un dessin susceptible de tout synthétiser par recourbures baroques : la bande dessinée primitive, l’école belge, l’underground… Un trait qui relie toutes les cruautés de la Terre en une gigantesque partouze volcanique qui crache, comme du feu, des nouveaux-nés… Willem, le dessin « total », comme on disait l’art total. Willem l’apothéose.
Et puis c’est tous les autres. Ceux qui étaient là avant : Bosc, Chaval, Maurice Henry, mais que Hara-Kiri a redéfini et resitué dans une histoire monumentale de l’humour cruel (de même qu’un écrivain créé ses prédécesseurs, Hara-Kiri, a lui seul, a inventé l’humour bête et méchant à travers les siècles). Il y a ceux qui sont devenus eux-mêmes à côté, mais étaient là très tôt : Lob, Moebius, Peellaert, Fournier, Copi… Tous les compagnons de route : Hopf, Guitton, Nicoulaud, Barbe, Serre, Pichon, Hugot… Et encore ceux d’aujourd’hui et de demain, que Hara-Kiri a formé et qui déploieront leurs ailes ensuite : Got, Carali, Charlie Schlingo, Masse, le jeune Nabe (à l’époque il avait 15 ans et demi et Reiser l’appelait « le seul dessinateur d’Hara-Kiri puceau »), Vuillemin, Placid, Muzo, Olivia Clavel, Pascal, Rémi… C’est simple : tous, ce sont les meilleurs. A croire que ceux qui ne sont pas passés par Hara-Kiri n’existèrent tout simplement pas.
Non seulement Hara-Kiri a réinventé l’humour, sous la forme la plus difficile, la plus extrême, mais Hara-Kiri a réinventé le dessin, par le coupant du sabre qu’il concurrence (Reiser), la vitesse des mouvements qu’il tente de rejoindre (Wolinski), la géométrie du déraillement que représente chaque pas de côté (Gébé), les hachures d’un monde tranché (Topor), le noir fibreux d’un monde mélancolique (Fred), les volutes et les courbes esthètes d’un cosmos qu’il s’agit de voir dans son exubérante violence et son insatiable sexualité (Willem). Si tout ce qui vaut quelque chose dans l’humour, depuis les années 70 jusqu’à aujourd’hui – Coluche, Desproges, Romain Bouteille, Luis Rego jusqu’à Laetitia Dosch – et même bien sûr ce qui ne vaut rien – tout le reste – n’existe que par Hara-Kiri ; tout ce qui a eu lieu dans le dessin également : Bazooka, Elles Sont de Sortie, Captain Cavern, Pyon, J.C. Menu, Mattt Konture, Killoffer, Sardon… La planète Hara-Kiri a avalé la Terre et elle ne fait plus qu’une avec elle. Bienvenue sur la planète enragée, où on s’encule et on s’éventre dans le cosmos, où il n’y a ni tendresse ni amour. La planète Hara-Kiri : Y en a-t-il jamais eu d’autre ?